Ceci est la traduction adaptée d’un article de Mac William Bishop, originalement publié par Rolling Stone le 5 janvier 2026. Nous republions l'article originalement intitulé Does Trump have a plan for Venezuela? avec la permission de son auteur. Notez que certaines subtilités et nuances peuvent différer de la version originale.
Lorsque les Américains se sont réveillés samedi en apprenant que les États-Unis avaient envahi le Venezuela et enlevé son président, ils s’attendaient sans doute à ce que leurs élus offrent une explication sur les raisons d’un tel geste.
Après des mois de renforcement militaire et d’activités dans les Caraïbes, il n’était pas surprenant que les États-Unis aient finalement décidé de se lancer dans une croisade visant à faire tomber le président vénézuélien Nicolás Maduro. Ce qui était stupéfiant, en revanche, c’est que la plus récente opération américaine de changement de régime semblait conçue pour laisser le régime en place.
Fort heureusement, le président Donald Trump est apparu samedi aux côtés de ses principaux ministres pour tout clarifier. Parmi les nombreux casus belli invoqués figuraient la guerre contre la drogue («ces drogues viennent surtout d’un endroit appelé le Venezuela»), l’immigration («ils ont envoyé tous les mauvais éléments aux États-Unis»), le terrorisme («une campagne incessante de violence, de terreur et de subversion»), et même la promotion altruiste des idéaux américains («nous voulons la paix, la liberté et la justice pour le grand peuple du Venezuela»).
Ah… et le pétrole. «Comme tout le monde le sait, l’industrie pétrolière au Venezuela est un échec, un échec total depuis longtemps. Ils pompaient presque rien comparativement à ce qu’ils auraient pu pomper», a déclaré Trump, promettant que des entreprises américaines iraient au Venezuela pour «commencer à faire de l’argent pour le pays».
À chacun de choisir laquelle de ces raisons constitue la véritable motivation de l’intervention militaire, ou d’en inventer une autre. Plusieurs semblent tout aussi plausibles que celles avancées: contrer l’influence chinoise dans les Amériques, affaiblir Cuba, flatter l’ego de Trump face à la défiance dansante de Nicolás Maduro, ou simplement une envie irrépressible d’afficher une brutalité purement américaine après des décennies de frustration et d’échecs en Irak et en Afghanistan.
C’est à la lumière de ces échecs que la chose la plus surprenante de la conférence de presse de samedi a été la déclaration sans détour selon laquelle l’Amérique prenait le contrôle de Caracas.
«Nous allons administrer le pays jusqu’à ce que nous puissions assurer une transition sécuritaire, appropriée et judicieuse», a affirmé Trump, ajoutant plus tard: «Nous n’avons pas peur de déployer des troupes au sol si nécessaire.»
Bien des observateurs n’auraient pas été plus abasourdis si un Oncle Sam sous stéroïdes avait défoncé la porte pour les assommer à coups de drapeau étoilé. Voilà un président américain ordonnant ouvertement un changement de régime et admettant l’installation d’un pantin, sans euphémisme diplomatique ni envolées idéalistes. Tout était au grand jour. L’Amérique prend le contrôle du Venezuela. Pourquoi? Pour faire de l’argent avec son pétrole. Comment? Grâce à la Delta Force, puis… un haussement d’épaules et un geste vague en direction du département d’État.
«[Le secrétaire d’État] Marco [Rubio] travaille directement là-dessus», a déclaré Trump, soulignant que la vice-présidente du Venezuela, une fidèle du régime, semblait avoir pris le relais après la disparition de Maduro dans la nuit avec plusieurs nouveaux «amis» américains. «Il a eu une conversation avec elle, et elle est essentiellement prête à faire ce que nous jugeons nécessaire pour redonner sa grandeur au Venezuela.»
Il était malheureusement ironique que, quelques heures plus tard, la femme en question, la présidente intérimaire du Venezuela Delcy Rodríguez, nie lors d’un discours télévisé toute collaboration avec les gringos. «Il n’y a qu’un seul président au Venezuela, et il s’appelle Nicolás Maduro.»
De nombreux opposants au régime se sont d’abord réjouis de la chute de Maduro, mais se sont montrés bien plus sombres en constatant que Rodríguez était désormais aux commandes et que la frappe de décapitation de Washington n’avait pas tranché la tête du serpent, mais retiré une tête à une hydre. Maduro est parti, mais son régime demeure en place.
«C’est la première fois que je me demande si je me retrouve du côté opposé de la politique américaine», confie à Rolling Stone un militant de l’opposition vénézuélienne. «Les États-Unis soutiennent maintenant le régime, plutôt que de s’y opposer.»
La situation demeurait toutefois fluide, ajoutant qu’ils croyaient que l’administration Trump traiterait avec «quiconque est le plus facile à manipuler, à corrompre et avec qui conclure des ententes».
«Quelle est la stratégie? Qui veulent-ils réellement voir au pouvoir?» demande un ancien soldat américain des forces spéciales, spécialiste de l’Amérique du Sud, qui a déjà travaillé dans la région.
Selon lui, la méfiance au sein du régime de Maduro atteindra bientôt un sommet, les hauts responsables étant convaincus qu’au moins l’un de leurs compatriotes collabore secrètement avec les Américains pour prendre le contrôle du pays. Avec la disparition de Maduro, un remaniement est inévitable et pourrait mener à des conflits internes, voire à une guerre civile.
«Nous nous dirigeons vers des montagnes russes de prétendants au trône. Mais quiconque accédera au pouvoir avec la bénédiction de Washington manquera de légitimité», observe l’ancien soldat, estimant que la seule chose capable d’unir véritablement les Vénézuéliens serait l’opposition au contrôle américain. «Après avoir déstabilisé le pays, que veut Washington?»
Excellente question.
On aurait difficilement pu imaginer un scénario mieux conçu pour mettre en valeur la puissance militaire américaine que le raid visant à enlever Maduro. Toutes les composantes d’élite de l’appareil militaire et sécuritaire des États-Unis ont été mobilisées. L’opération constituait un témoignage éloquent des milliers de milliards de dollars investis dans l’armement de pointe, combinés à des décennies d’expérience concrète en opérations spéciales.
Que Washington dispose d’outils militaires surpassant ceux de tout concurrent ne fait aucun doute. Le problème est que les victoires tactiques ne garantissent pas le succès stratégique. L’idée qu’un pays puisse surgir de nulle part et remodeler un autre gouvernement à sa convenance par la force, sans complications, relève de l’illusion. Il suffit de penser à l’Amérique en Irak ou en Afghanistan, ou à la Russie en Tchétchénie ou en Ukraine.
De nombreux commentateurs se concentrent sur les implications plus larges du raid au Venezuela, sur sa légalité ou sur l’idée qu’il inaugure une nouvelle ère de realpolitik à la manière de Thucydide, où «les forts font ce qu’ils peuvent, et les faibles subissent ce qu’ils doivent».
Qu’est-ce qui empêcherait alors la Russie ou la Chine d’en faire autant, en Ukraine ou à Taïwan?
Il n’est pas nécessaire d’être cynique pour penser que la réponse tient moins aux normes du droit international qu’à la pure capacité militaire. La Russie a d’ailleurs tenté à plusieurs reprises de capturer le président Volodymyr Zelensky au début de son invasion à grande échelle de l’Ukraine, en février et mars 2022. Elle a échoué, au prix de lourdes pertes dans ses unités de forces spéciales.
L’incursion de Trump au Venezuela constitue indéniablement un succès militaire. Ses implications plus larges restent à déterminer. Mais il s’agit d’une étape supplémentaire vers une présidence impériale débridée, qui s’emploie activement à démanteler un système mondial que l’Amérique elle-même a contribué à créer, tout en semant le chaos au pays comme à l’étranger.
Les paravents juridiques n’ont jamais suffi à empêcher les puissants de s’en prendre à leurs voisins plus faibles, et la plupart des dirigeants mondiaux mettent de côté la légalité et la morale lorsque leurs intérêts l’exigent. Trump n’est pas le premier. L’ordre international longtemps défendu par les États-Unis repose sur un système de deux poids, deux mesures, appliqué de façon hypocrite ou abandonné selon les caprices de Washington.
L’idée que ce système ait profité aux États-Unis est rejetée par les fidèles du mouvement MAGA. Selon eux, puisque la plupart des nations agissent en fonction de leur propre intérêt, l’ère du «America First» représente au moins une version plus honnête des relations internationales.
On peut aussi appeler ce système la loi de la jungle.
Sauf que, bien sûr, aucun animal dans la jungle ne possède d’arme nucléaire.









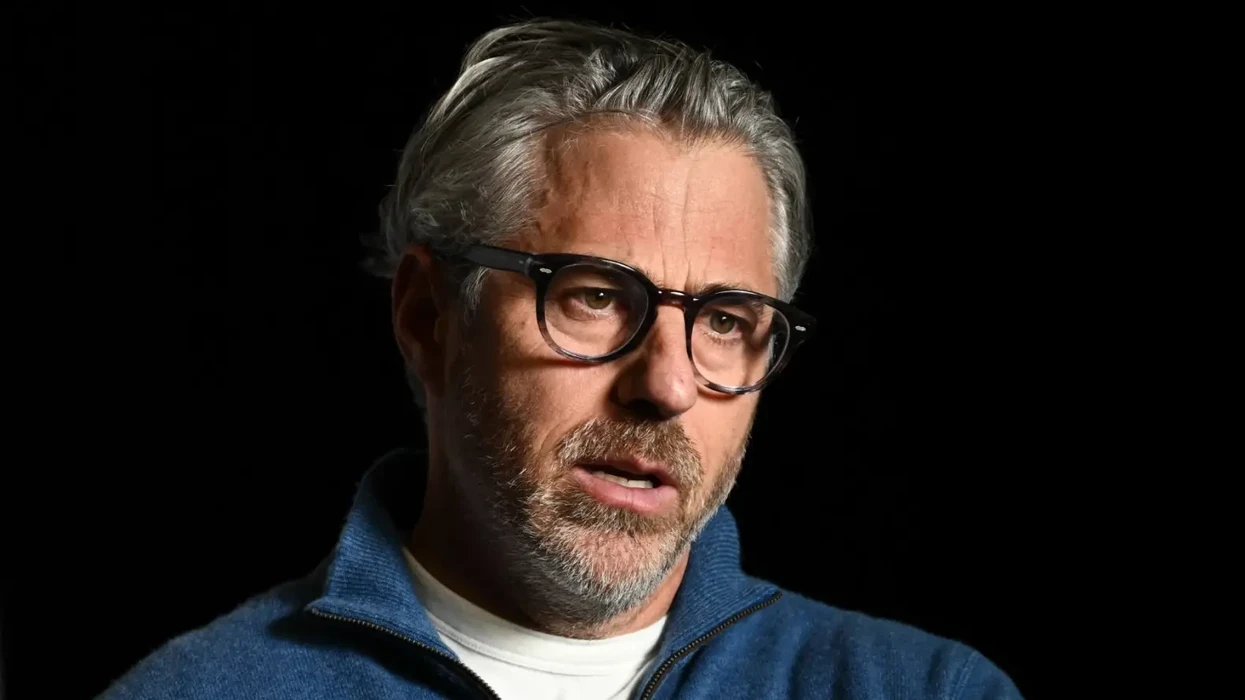






 Kabir Sehgal, enfant, qui rencontre le dalaï-lama.Courtoisie de Kabir Sehgal
Kabir Sehgal, enfant, qui rencontre le dalaï-lama.Courtoisie de Kabir Sehgal Amaan Ali Bangash, sa Sainteté, Amjad Ali Khan, et Ayaan Ali Bangash. Courtoisie de Amjad Ali Khan
Amaan Ali Bangash, sa Sainteté, Amjad Ali Khan, et Ayaan Ali Bangash. Courtoisie de Amjad Ali Khan